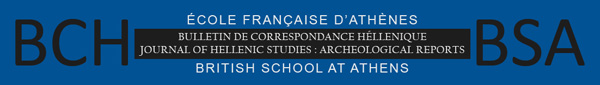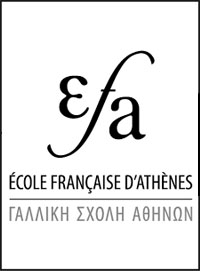SAMOS - 1981
Heraion de Samos (sanctuaire)
Fouilles de l'Institut allemand. — L'exploration de la zone Nord-Est de l'Héraion a été poursuivie en 1981 par et ses collaborateurs, en vue de résoudre plusieurs questions laissées pendantes à l'issue de la dernière campagne.
1) On a étendu la fouille de 25 m vers le Nord et de 38,5 m vers l'Est, dans l'espoir de rencontrer la limite Est du sanctuaire et son entrée principale. Mais toute cette zone se trouve encore à l'intérieur du téménos, comme le prouve la série de bases d'offrandes qui se prolonge jusqu'à l'extrémité orientale de la fouille. Le sanctuaire est donc considérablement plus étendu qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant.
2) Le dallage de la voie sacrée a été dégagé dans toute cette zone et sa position chronologique au début du IIIe siècle ap. J.-C. confirmée par des trouvailles en stratigraphie, notamment un bronze de Caracalla retrouvé dans le substrat pierreux. On a également pu observer pour la première fois sur une bonne distance l'état archaïque de la voie sacrée, qui est pavée de galets et suit le même tracé que la future voie impériale, à 0,60 m au-dessous d'elle.
3) Aucun vestige d'habitation d'époque impériale n'a été retrouvé cette année près de la voie sacrée, mais seulement de très longs murs romains tardifs, qui ne peuvent guère être interprétés que comme des murs de clôture. L'épaisse couche de débris déjà rencontrée l'an dernier au Nord de la voie sacrée a livré quelques monnaies qui permettent de la dater au plus tôt de la fin de la première moitié du IVe siècle ap. J.-C.
4) La fouille du bâtiment archaïque repéré en 1980 à l'extrémité Nord de la fouille (v. BCH 105 [1981], p. 861) a montré qu'il s'agissait sûrement d'un temple (fig. 143). Seul l'angle Sud-Est, arasé au niveau des fondations, se trouve dans les limites du terrain. Les murs de fondation, épais de 1,20 m, sont en calcaire, le mur Sud étant pourvu, à intervalles réguliers, de saillies qui évoquent des antes. Ce mur a une longueur de 20 m au moins, ce qui donne une idée des dimensions imposantes de l'édifice. Son orientation est identique à celle du « bâtiment Nord ». Il était construit sur une terrasse rectangulaire large de 39,50 m et d'orientation légèrement différente, parallèle à la voie sacrée, qu'elle dominait d'au moins 1,20 m. Dans le mur Sud de cette terrasse se trouvaient remployés des tambours de colonnes archaïques et des orthostates disposés en boutisse, à intervalles réguliers, en saillie vers l'extérieur. Comme on l'avait constaté l'an dernier, certains de ceux-ci sont décorés.
Au Sud de l'angle Sud-Est de ce mur on a trouvé, dans un niveau archaïque, un groupe d'objets en bronze qui étaient visiblement déjà endommagés lorsqu'ils furent déposés là : parmi eux des protomès de griffons de taille et de type divers, un petit kouros presque complet d'excellente facture et une tête de statue masculine.
5) La fouille des constructions préhistoriques précédemment localisées (v. ibid., loc. cit.) a permis d'y reconnaître au moins trois phases architecturales, toutes assignables au Bronze Ancien (fig. 144). La plus récente est représentée par de vastes maisons rectangulaires aux murs en moellons. A un niveau sensiblement plus bas on a rencontré un mur de fortification avec une tour, conservé sur plus de 2 m de haut, ainsi qu'un soubassement de mur en pierre dont les dimensions font supposer qu'il appartenait à un très grand édifice. A cette phase se rattachent plusieurs soles de foyer ou de four, dont deux au moins devaient être couvertes par une coupole. Des traces d'incendie ont été observées dans la couche de destruction. Le niveau de la nappe phréatique n'a pas permis de dégager complètement les quelques murs sous-jacents qui correspondent à une phase encore plus ancienne.
On peut observer dès à présent que ces vestiges préhistoriques remontent plus haut dans le temps que ceux qui avaient été fouillés naguère dans les zones centrale et septentrionale de l'Héraion. En effet, si le dernier niveau d'occupation BA mis au jour cette année, immédiatement sous les couches archaïques, appartient à l'horizon « Héraion I » de Milojcic, le niveau sous-jacent correspond à l'horizon Troie I. Quant au niveau inférieur, qu'il est encore impossible de dater avec certitude, il n'est, selon toute apparence, probablement pas postérieur au début du IIIe millénaire. A l'Est, une épaisse couche de galets témoigne de l'existence d'un lit de rivière, qui marquait la limite orientale de l'établissement préhistorique et demeura vierge de toute construction jusqu'à l'époque archaïque.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran