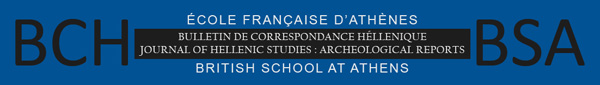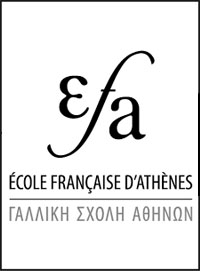KALAPODI - 1982
Kalapodi, Kalapodion, Abai
Fouilles de l'Institut allemand. — Les recherches menées en 1982 par dans le sanctuaire ont porté essentiellement sur les niveaux de transition du Submycénien au Protogéométrique à l'Est, les fondations du petit temple archaïque périptère et le temple proto-archaïque sous-jacent au Sud, avec quelques compléments de fouille sous le grand temple Nord.
1) Sur le flanc Est du sanctuaire mycénien on a découvert les vestiges d'une petite construction carrée qui n'est pas antérieure à l'HR III C avancé et semble difficilement, vu le matériel associé, pouvoir être interprétée comme une maison. Au-dessus s'élevait un cône fait d'une succession de couches d'argile brûlée avec passées cendreuses, restes probables de foyers ou d'autels en plein air de la fin de l'HR III C et de la transition au Protogéométrique. C'est ce que confirme d'ailleurs la présence, au sommet du cône, d'un foyer du Géométrique Ancien déjà découvert en 1979 (fig. 58). Parmi les trouvailles correspondant aux niveaux inférieurs figurent de nombreux cylindres en argile peu cuite, qui ont des parallèles dans les maisons HR III C de Lefkandi mais dont la fonction demeure mystérieuse.
La céramique — pour l'essentiel monochrome ou domestique, avec une forte proportion de vases non tournés et de pithoi — offre quelques nouveaux exemples de décor au compas, tous issus du niveau HR III C tardif. C'est ainsi que, dans le motif mycénien de la spirale alternée qui orne un fragment d'épaule de cruche ou d'amphore, la spirale est remplacée par des cercles concentriques au compas. Du point de vue de la qualité et du style, la céramique mycénienne de Kalapodi — dont achève actuellement l'étude — est très proche de celle de Lefkandi. Les couches mycéniennes ont également livré de nouveaux petits objets, ce qui porte leur nombre total à plus de deux cents, dont une soixantaine d'objets en bronze. Ceux-ci sont surtout des objets de parure et des outils (couteaux, scies, râcloirs, burins), mais aussi des déchets de fonte, qui impliquent l'existence d'ateliers de bronziers dans le sanctuaire.
2) La poursuite de l'exploration du temple proto-archaïque qui précéda le petit temple archaïque Sud a d'une part permis d'en préciser le plan et les dimensions, d'autre part fourni une image plus complète du programme architectural qui remodela le sanctuaire aux environs de 700 av. J.-C. (fig. 65).
Ce temple est orienté Est/Ouest, en biais par rapport au temple archaïque qui le recouvre. C'est un édifice prostyle à quatre colonnes, long de plus de 22 m (29 m au maximum) et large de 7,50 m environ. Les murs de la cella sont en brique crue sur un socle en brèche de 0,40 m de haut flanqué intérieurement — comme dans le temple primitif d'Apollon à Porto-Chéli — de petits piliers en pôros qui devaient supporter des poteaux en bois étayant les murs et soutenant le toit. A ces bases semble correspondre une rangée de trous de poteaux alignés selon le grand axe de l'édifice, ce qui invite à restituer — sur la cella du moins — un toit à double pente .
La façade de la cella est constituée par deux antes encadrant un large seuil en bois, alors que le temple Nord contemporain, qui est dépourvu de vestibule, possède un seuil en pierre. L'angle Nord- Est du mur de la cella est exceptionnellement bien conservé, sur onze assises de briques crues qui présentent une particularité dont on ne connaît pas d'autre exemple en Grèce à cette époque : l'alternance régulière de deux couleurs de briques nettement contrastées (noir et jaune clair) qui produit un décor bichrome de bandes horizontales, l'ordre des couleurs s'inversant en outre à l'angle des murs (fig. 59). L'absence de toute trace d'enduit sur les deux parements confirme que cet effet décoratif était intentionnel.
Du point de vue du plan on observe que les murs de la cella convergent sensiblement du côté de la façade, comme dans le temple Β de Thermos ou l'édifice géométrique absidal d'Érétrie, mais on n'a pas encore pu déterminer si, à l'Ouest, la cella était absidale ou rectangulaire.
Sur le sol en terre battue on a retrouvé des traces de la toiture en roseaux et en torchis, qui a brûlé et s'est effondrée. On a également recoupé, au milieu de la cella, une épaisse couche de cendre blanche qui suggère l'existence d'un autel analogue à celui du temple Nord.
La façade de la cella est précédée par un vestibule à quatre colonnes dont l'angle Nord-Est est recouvert par la rampe du temple archaïque, ce qui a nécessité une fouille en sape. Le stylobate en Π du vestibule, fait en gros blocs de pôros, a conservé l'empreinte très nette des deux colonnes Nord — certainement en bois — qui mesuraient 0,52 m de diamètre.
Ce temple brûla pendant le VIIe siècle av. J.-C. et fut réparé peu après le milieu du siècle : la large porte Est fut murée à l'aide de briques d'un module différent des premières, et l'accès se fit désormais par une porte latérale — qui existait peut-être déjà dans le premier état — à la partie postérieure du mur Sud. Dans l'axe de la cella on édifia, derrière l'autel présumé, une construction rectangulaire de 2,90 m de long sur 1,40 m de large et 1 m de haut, en brique crue recouverte d'enduit blanc sur socle en pôros (fig. 60). Aucune trouvaille ne nous renseigne directement sur la fonction de cette structure, mais, si l'on remarque que, juste au-dessus d'elle se dresse un enclos en orthostates de pôros qui, à l'époque classique, remplaça modestement le temple archaïque détruit par les Perses et représente donc en fait le dernier lieu de culte à cet endroit (fig. 61), alors on devra conclure que c'était là le cœur non seulement du temple archaïque mais aussi du temple proto-archaïque.
Un sondage profond à cet endroit a livré les traces d'installations plus anciennes, dont l'interprétation est rendue difficile par l'exiguïté de la fouille : une estrade (?) faite de briques crues posées de chant sur un sol brûlé du VIIIe siècle av. J.-C. ; au-dessous un monticule de pierres vraisemblablement protogéométrique ; enfin, immédiatement au-dessus du sol vierge, un sol d'époque mycénienne dans lequel est enchâssée — exactement au centre du futur enclos sacré — une cuvette en argile crue du type des silos mycéniens (fig. 62), ce qui laisse à penser que, dès cette époque, l'endroit jouait un rôle central dans la vie cultuelle.
La fouille sous le temple archaïque Sud a également permis de préciser la date de celui-ci. En effet, entre la destruction du sanctuaire proto-archaïque et la reconstruction du VIe siècle av. J.-C, fut creusée, devant la structure rectangulaire décrite ci-dessus, une fosse qui contenait des ex-voto en bronze (anneaux, bagues) et quelques vases : parmi ceux-ci un bel aryballe protocorinthien décoré d'une chouette et d'un porc sauvage, et trois cotyles corinthiens noirs à bandes rouges et blanches dont l'un est manifestement postérieur à la fin du Corinthien Moyen. Cela fournit un terminus post quem pour la construction du petit temple archaïque périptère, de même que pour les chapiteaux primitifs (fig. 63-64) et le toit « à cornes ».
3) Un complément de fouille sous le péristyle Sud du grand temple classique, au Nord, a définitivement fait disparaître tout espoir d'en apprendre plus sur le plan et les dimensions du temple proto-archaïque sous- jacent, en grande partie démoli lors de la construction du temple archaïque qui lui succéda. On remarquera toutefois que la dernière pierre de son mur Sud conservée à l'Ouest, est un bloc de pôros identique à ceux du seuil Est, ce qui suggère que le temple Nord possédait, comme le temple Sud, une porte latérale — trait que l'on rencontre ici pour la première fois en dehors du Péloponnèse (Bassae, Tégée, Némée) et à une date beaucoup plus haute.
Parmi les trouvailles de la campagne, en plus des pièces déjà mentionnées on retiendra seulement une anse fragmentaire de trépied du VIIIe siècle av. J.-C. Elle mesure plus de 30 cm de diamètre, est décorée d'un motif en zigzag, et présente des défauts de fabrication qu'une réparation maladroite a tenté de masquer.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran