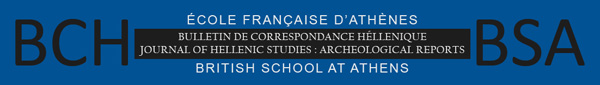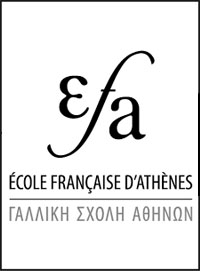KALAPODI - 1981
Kalapodi, Kalapodion, Abai
Fouilles de l'Institut allemand. — et ses collaborateurs ont poursuivi, en 1981, l'exploration des niveaux primitifs du sanctuaire.
En Κ 25-26 (ν. plan dans BCH 104 [1980], p. 625/626, fig. 92), un premier sondage a atteint le sol vierge, recoupant, dans les couches HR III C, un mur isolé qui retenait peut-être une terrasse du sanctuaire mycénien. Sous l'esplanade du temple proto-archaïque (v. ci-dessous), un deuxième sondage, mené presque jusqu'à la base des couches protogéométriques, a produit un riche matériel stratifié Protogéométrique Ancien, Protogéométrique Récent, Géométrique Moyen et Géométrique Récent. Si les objets en fer et en bronze sont encore rares dans les niveaux du Géométrique Moyen, ils deviennent très nombreux dans les dépôts de sol et de remplissage du Géométrique Récent. Quant à la céramique, elle témoigne d'une évolution continue du Mycénien tardif au Protogéométrique Ancien (fig. 55) et Récent.
On a sondé en plusieurs points les niveaux sous-jacents au grand temple archaïque, afin de déterminer les dimensions exactes du temple proto-archaïque précédemment reconnu (v. BCH 105 [1981], p. 809-812). Du mur Nord de celui-ci on n'a retrouvé qu'une tranchée de récupération. La fondation du mur Sud a été suivie sur 22 m de long, mais sa longueur totale est sans doute inférieure à 29 m. Peut-être le terrain montait-il vers l'Ouest et les fondations de l'édifice furent-elles coupées ultérieurement de ce côté-là par la construction de la cella archaïque. A l'Est, sous le péristyle du temple classique, l'entrée de l'édifice a été nettoyée (fig. 56) : elle comportait deux piliers rectangulaires servant de piédroits et deux colonnes in antis en bois de 0,50 m de diamètre environ.
Au-dessous de cet édifice se succèdent plusieurs sols géométriques, mais on n'a encore retrouvé aucun mur qui leur corresponde. Dans le niveau immédiatement sous-jacent au sol du temple proto-archaïque est apparue une fosse ovale entourée de grosses pierres et remplie de pierres plus petites dont la surface, brûlée, est recouverte d'une mince couche de cendre blanche mêlée de débris d'os calcinés. Le remplissage lui-même n'ayant pas encore été fouillé, on peut seulement dire qu'on est en présence d'une installation sacrificielle.
Devant le temple proto-archaique, construit vers 700 av. J.-C. ou peu après et demeuré en place pendant tout le VIIe siècle, s'étend l'esplanade avec son dépôt de cendre (v. Archäologischer Anzeiger 1980, p. 48/49, fig. 7 et p. 63-65). L'esplanade est limitée à l'Est par un bâtiment allongé (fig. 57), dont on n'a encore fouillé que la partie Sud. Une ou deux assises de briques crues sont encore en place sur le socle des murs, tandis qu'à l'intérieur une série de blocs isolés correspond sans doute à une colonnade axiale.
La campagne de 1981 a d'autre part confirmé que le petit temple archaïque découvert au Sud du grand (v. BCH 104 [1980], p. 627) avait lui aussi un ancêtre proto-archaïque contemporain de celui du grand temple. De cet édifice on n'a guère recoupé, jusqu'à présent, qu'un mur (dans une tranchée correspondant au mur de façade pillé de la cella archaïque) qui a conservé quatre assises de briques crues sur un soubassement en moellons. Le sol correspondant montrait, à l'intérieur comme à l'extérieur, des traces de feu. Lors de l'aménagement du sanctuaire archaïque, cet édifice, qui était alors en ruine, fut recouvert par un remblai de 1,50 m d'épaisseur qui le préserva. A la différence des futurs temples, tournés vers le Nord-Est, celui-ci semble bien avoir été orienté à l'Est : l'esplanade avait donc la forme d'un triangle irrégulier, ce qui n'est pas sans analogie avec l'Héraion primitif de Samos.
Sous le péristyle de la façade du grand temple classique, au Nord, on avait découvert, en M 24-25, un tronçon de fondation qui avait coupé le mur Nord du temple proto-archaïque (v. BCH 105 [1981], p. 812). Ce tronçon correspond, d'après la stratigraphie, à une phase architecturale intermédiaire entre le temple proto-archaique et le temple archaïque, phase qu'il faut probablement dater de la fin du VIIe siècle av. J.-C. Mais la fonction de ce mur n'a toujours pas pu être éclaircie : peut-être s'agit-il d'une reconstruction inachevée.
La fouille de ce dernier secteur a d'autre part montré que le grand temple archaïque, qui a conservé les orthostates de sa cella sur 33 m de long, était un temple périptère. Si les colonnades Sud et Est de ce temple ont été entièrement détruites ou recouvertes par celles du temple classique, la colonnade Nord est encore attestée par une tranchée de récupération bien visible. Cela permet de donner, pour le péristyle du temple archaïque, les mesures approximatives de 42,50 x 16,60 m, soit 6 x 16 ou 6 x 17 colonnes. La découverte quelque peu problématique d'un tesson sous le sol de la péristasis n'exclut pas qu'il faille descendre le début de la construction de ce temple après 560 av. J.-C.
Parmi les trouvailles de la campagne on retiendra, outre la céramique protogéométrique et géométrique, de nombreux objets de parure en bronze d'époque géométrique (épingles, fibules, bracelets, pendentifs, perles). Il faut aussi signaler une phalère à rebord intacte du Géométrique Récent et l'arc d'une fibule à plaque trouvée dans un dépôt du VIIe siècle av. J.-C.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran