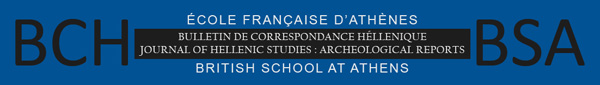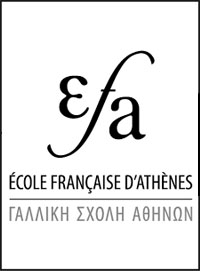RHAMNONTE - 1982
Rhamnonte, Rhamnous
Fouilles de la Société archéologique. — En 1982 a fouillé dans le sanctuaire de Némésis et sur la voie sacrée Sud.
1) La poursuite de la fouille sur la terrasse du sanctuaire a permis de conclure à l'existence d'un petit temple du début du VIe siècle av. J.-C, auquel il convient de rattacher une tête de sphinx en terre cuite (fig. 17) et un kalyptère de tuile laconienne frappé d'un lion. Cette découverte fait remonter le culte de Némésis bien plus haut que les guerres médiques, contrairement à une tradition probablement née du désir qu'avaient les habitants de Rhamnonte de lier leur sanctuaire à la bataille de Marathon. La fouille de la terrasse a aussi produit de la céramique archaïque contemporaine du temple — notamment des fragments de loutrophore, caractéristiques des cultes chthoniens — et, dans les couches profondes, des tessons HA, HR et géométriques.
Un sondage à l'intérieur du temple polygonal, qui date des premières décennies du Ve siècle av. J.-C, a montré que l'espace était vierge de toute construction antérieure. Le temple primitif devait donc s'élever sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le grand temple.
A douze mètres au Nord de celui-ci on a découvert les restes d'une fontaine, dont le bassin fut creusé dans le rocher avant le remblayage de la terrasse, et qui demeura en usage pendant tout le Ve siècle av. J.-C. La façade était constituée par deux colonnes monolithiques en marbre de 2,07 m de haut. Dans la couche supérieure en place on a retrouvé deux têtes de figurines de la première moitié du Ve siècle av. J.-C. ainsi que des fragments de céramique à figures rouges sensiblement contemporains.
2) Un petit sondage sous le dallage de la voie sacrée Sud, qui aboutit au sanctuaire de Némésis, a produit un périrrhantérion votif inscrit et un relief votif qui représente Héraklès au repos tenant un canthare et une corne d'abondance (fig. 18). Dans un autre sondage, à l'Est du mur d'analemma de cette voie, à quelque 60 m du grand temple, on a découvert des vestiges très ruinés de constructions mycéniennes aux murs épais, qu'il est tentant de mettre en rapport avec le culte de Thémis et de Némésis. D'autre part il s'est avéré que la « base de Claude » était vraisemblablement un autel du IVe siècle av. J.-C. plus tard consacré à l'empereur, de la même façon que le grand temple fut dédié à Livie, dont le buste fut dressé à l'intérieur.
Enfin dans la grande salle qui abrite la frise du temple reconstituée, on a remonté deux monuments funéraires, le naïskos de Pytharchos et celui de Diogeiton avec ses deux statues (fig. 19). Ergon 1982 (1983)., p. 34-36.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran