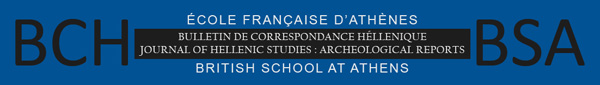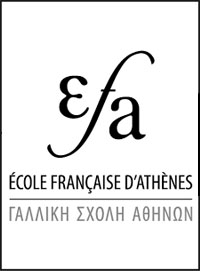PAROS - 1981
Technische Universität München (TUM) (Université technique de Munich)
Deutsches Archäologisches Institut (DAI) (Institut archéologique allemand)
Paros, Paroikia
Travaux de l'Université technique de Munich. — L'enquête sur les monuments antiques de Paros a été poursuivie en 1981 par et ses collaborateurs, qui font le point sur les acquis des campagnes précédentes dans l'Archäologischer Anzeiger 1982, p. 159-290 et 621-689.
1) Temple A. — La reconstitution du temple ionique amphiprostyle proposée ibid., p. 197-229 a été confirmée par l'identification d'un tore décoré de neuf cannelures horizontales, retaillé et réutilisé comme pierre tombale dans l'église Saint-Jean de la forteresse. Le diamètre de la base étant de 1,22 m, celui de la colonne devait être voisin de 0,96 m. D'autre part on a nettoyé, dans une cave jusqu'alors inaccessible, un segment de la fondation du mur Est du temple, avec l'assise inférieure de sa krèpis en marbre in situ.
2) Sanctuaire d'Apollon Délien. — Poursuivant l'étude du temple d'Artémis (ibid., p. 231-244), M. Schuller a conclu que l'appareil des murs extérieurs et du pronaos était constitué d'orthostates et de blocs ravalés, tandis que le parement interne des murs de la cella était fait — selon une habitude répandue dans les Cyclades — à l'aide de petits blocs qui étaient sans doute stuqués. La hauteur minimum des murs a pu être estimée à cinq fois un quart le diamètre des colonnes. Une nouvelle précision sur la toiture a été apportée par le raccord d'une tête de lion à l'acrotère d'angle (fig. 126). Quant à l'autel, on peut désormais le restituer avec une marche au moins et des murs latéraux en saillie.
3) Temple d'Apollon Pythien. — Deux blocs de couronnement et une cymaise haute de 30 cm — retaillée ultérieurement pour servir de gargouille — ont pu être assignés à ce temple tardo-classique, dont on ne peut toujours préciser s'il était périptère ou amphiprostyle (ibid., p. 245-264).
4) Hérôon d'Archiloque. — Après avoir reconstitué l'hérôon lui-même (v. BCH 105 [1981], p. 854, fig. 162 ; ArchAnz 1982, p. 271-290), A. Ohnesorg a examiné d'autres fragments architectoniques provenant du même secteur. Les deux orthostates avec l'inscription de Mnésipès, dont il s'avère qu'ils encadraient une niche (relief ?, entrée ?, escalier ?), pourraient appartenir au mur du péribole, tout comme les orthostates qui portent l'inscription de Sosthénès du Ier siècle av. J.-C.
5) Temple archaïque tardif dans la ville. — Sept chapiteaux doriques, retravaillés et réutilisés à l'époque byzantine comme supports intérieurs dans la chapelle Saint-Nicolas près de la Katapoliani (fig. 127), ainsi qu'un fragment d'architrave (entrecolonnement : 2,15 m environ) et un bloc d'architrave intérieure (entre-colonnement : 2,40 m) appartiennent à un temple de la fin de l'archaïsme jusqu'alors inconnu. L'ordre intérieur devait comporter deux étages de colonnes doriques comme le temple d'Aphaia à Égine.
6) Autels. — On a retrouvé à la Katapoliani un bloc d'angle de l'assise de couronnement du grand autel reconstitué dans l'ArchAnz 1982, p. 184-190. Ce bloc, retaillé en chapiteau de pilastre au début de l'époque byzantine (fig. 128), avait ensuite été incorporé dans le mur Nord de la chapelle Saint-Jean.
C'est à un autre autel, sans doute du IVe siècle av. J.-C, que doit appartenir un bloc mouluré (cavet et filet) découvert fortuitement lors de travaux sur le port.
Enfin la table d'un autel hellénistique dont les rebords sont ornés d'un fronton a été retrouvée dans la sacristie de la Katapoliani (fig. 129). Cette découverte porte à dix le nombre des autels pariens connus jusqu'à présent, et qui s'échelonnent entre le VIe et le IIe siècle av. J.-C.
7) Édifice ionique prostyle. — Un chapiteau d'angle nouvellement trouvé témoigne de l'existence d'un élégant temple ionique du IIIe-IIe siècle av. J.-C. dont les colonnes, hautes de 4,20 m environ, devaient être espacées de 1,80 m. Un bloc d'architrave remployé dans la forteresse semble bien, d'après son style et ses mesures, pouvoir lui être aussi attribué.
8) Théâtre. — On a identifié au total onze sièges de la proédrie, réutilisés dans la basilique de Katapoliani où ils constituaient la rangée supérieure du synthronon.
9) Temple de Marmara. — Poursuivant l'examen des éléments d'architecture dorique disséminés près de Marmara (ibid., p. 265-270), K. Schnieringer a identifié un fragment de geison avec mutule complet, un triglyphe, onze nouveaux tambours de colonnes ainsi qu'un gorgerin et une échine du chapiteau. On peut donc restituer sans lacune le soubassement et la colonnade de ce temple de la fin de l'époque classique.
C'est à un autre temple dorique, de la fin du VIe siècle av. J.-C, plus petit et manifestement prostyle, qu'appartiennent deux chapiteaux presque identiques, dont l'abaque mesure 0,75 m de large tandis que le diamètre supérieur de la colonne est de 0,44 m.
Deux bases de colonnes ioniques témoignent, enfin, de l'existence d'un troisième édifice sacré dans la région de Marmara : il s'agit apparemment d'un temple ionique du Ve siècle av. J.-C.
10) Carrières antiques. — Dans le cadre d'un programme de recherche de l'Université libre de Berlin, K. German, géologue, H. Knoll, chimiste, et V. Valis ont exploré les carrières de marbre de Paros et de Naxos, découvrant des zones d'extraction dont l'étendue considérable donne, pour la première fois, une idée du volume des exportations de marbre dans l'Antiquité (fig. 130). Des échantillons ont été prélevés dans toutes les carrières aux fins d'analyse.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran