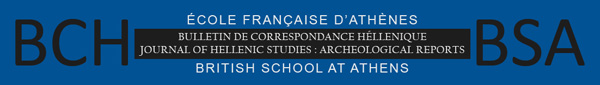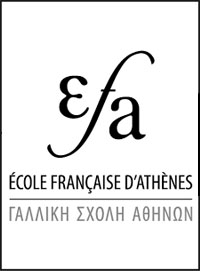ÉRÉTRIE - 1981
Fouilles de l'École suisse.
La campagne de 1981 a été consacrée à des recherches topographiques et à la poursuite des fouilles sur l'agora, dans le secteur G 10 et au sanctuaire d'Apollon, avec un sondage complémentaire dans le « bâtiment III » situé près de la porte Ouest. Ces recherches se sont complétées, sur le terrain, par des séries de mesures géophysiques et, au musée, par des travaux de restauration.
Recherches topographiques. — Le tracé de l'ancien delta fluvial ayant été précédemment reconnu (v. BCH 105 [1981], p. 847), C. Krause, A. Tuor et ont centré les recherches sur la zone comprise entre les deux branches de celui-ci. Il s'agissait de vérifier l'hypothèse, suggérée par le dessin même du réseau urbain primitif, selon laquelle les rues mises en place au VIIIe siècle av. J.-C. correspondaient — comme l'artère principale d'époque archaïque (v. BCH 104 [1980], p. 656) — à des cours d'eau asséchés. Cette hypothèse a été confirmée par les résultats de deux sondages effectués sous deux rues convergentes au tracé manifestement « organique » (fig. 115, nos 1 et 2) : on y a mis en évidence, sous le sol primitif de chacune des deux rues, un lit de ruisseau avec dépôts alluviaux. La preuve a contrario a été fournie par le sondage 3, dans une rue que son tracé rectiligne faisait présumer récente, et sous laquelle on n'a effectivement rencontré aucun lit de ruisseau. Les résultats des deux premiers sondages devront bien entendu être testés sur une plus grande étendue par une série de mesures de résistivité, que l'actuel développement urbain rend aussi urgentes que difficiles. Mais on peut d'ores et déjà, dans les sondages d'urgence, considérer la présence de dépôts alluviaux comme l'indice possible d'un axe de circulation.
Dans le secteur Ε 12, d'autre part, à l'occasion d'une fouille d'urgence à l'Ouest du terrain Karabetsos, un sondage complémentaire a permis de dégager un nouveau tronçon de la canalisation publique qui y avait été découverte antérieurement (ibid., p. 659). Il s'agit d'un canal à ciel ouvert de 2 m de large sur 1 m de profondeur, dont le fond est dallé et les parois constituées par deux assises de blocs de pôros isodomes. Le sondage se trouve au point de rencontre du canal et d'une rue qui, d'après les observations qu'on a pu faire, franchissait celui-ci à l'aide d'une passerelle en bois. Ce canal, dont on suit désormais le tracé sur une trentaine de mètres, se dirige en ligne droite vers la porte Ouest sans tenir aucun compte de la trame urbaine, qu'il coupe obliquement. On serait tenté de mettre cet ouvrage en rapport avec les travaux de drainage effectués, d'après les inscriptions, entre 322 et 308 par un certain Chairéphanès, si les données de la fouille ne conduisaient à une datation plus basse.
Agora. — La poursuite, par la même équipe, de la fouille du bâtiment archaïque sous-jacent à la stoa Est d'époque classique a permis de confirmer qu'il s'agissait bien déjà d'une stoa (fig. 116-117). On en a dégagé trois boutiques carrées de 5,40 m de côté pourvues d'une porte axiale de 1,40 m de large. Des traces du remaniement ultérieur de l'édifice, qui fut compartimenté par des cloisons faites de blocs de pôros remployés, ont de nouveau pu être observées et définitivement datées du Ve siècle av. J.-C, grâce à un trésor de quelque cent vingt monnaies retrouvé dans l'angle Sud-Est de l'une des boutiques.
Du portique classique qui s'y superpose on a dégagé plusieurs tronçons de la façade Ouest ainsi que les fondations de trois nouveaux supports intérieurs, ce qui permet de déterminer plus précisément la mesure de leur entrecolonnement (4,90 m). Plusieurs indices permettent en outre de conclure que le portique classique fut reconstruit — de façon relativement médiocre — sans doute après sa destruction totale en 198 av. J.-C On n'a jusqu'à présent pas retrouvé le moindre élément d'élévation du monument classique original et l'on est tenté de croire que les blocs en ont été systématiquement démontés pour alimenter le marché romain des œuvres d'art, qui s'étendait aussi à l'architecture.
Secteur G 10-1. — Avec le dégagement du four de potier préhistorique repéré en 1980, A. Tuor a achevé cette année la fouille d'urgence du terrain Vouratsas, où sont conservés, sur 800 m2 de superficie, des niveaux intacts de l'âge du Bronze. Le terrain, situé près de l'angle Nord-Est de l'agora, a également livré deux tombes géométriques ainsi que des restes de constructions classiques et hellénistiques, qui oblitèrent quelque peu le plan des vestiges préhistoriques (fig. 118).
Le four, situé au-dessous de la nappe phréatique — particulièrement haute cette année à cause de l'abondance des pluies hivernales — a pu être dégagé avec le secours d'une pompe (fig. 119). Il a ensuite été recouvert d'une couche de polyuréthane armé puis a été hissé (fig. 120) et transporté au musée, où on l'a débarrassé de son enveloppe et restauré dans son état primitif (fig. 121).
Comme on l'avait déjà constaté l'an dernier, il s'agit d'un four cylindrique, relativement petit mais remarquablement bien conservé (v. BCH 105 [1981], p. 847-850). La fouille de cette année a permis d'observer qu'un conduit d'aération, ménagé au Sud du four, aboutissait en biais à la chambre de chauffe souterraine ; que le sol de celle-ci était recouvert d'une couche de cendre et de charbon de bois de 7 à 10 cm d'épaisseur résultant de la combustion de branchages et de broussailles — dont on a prélevé des échantillons pour analyse au C14 — ; que la chambre de chauffe était enterrée dans une fosse de 1,40 m de diamètre sur 1 m de profondeur aux parois revêtues de petits moellons jointoyés à l'argile ; enfin que les parois de la chambre de cuisson, presque entièrement arasées mais dont la hauteur ne devait pas excéder 1 m, étaient construites de la même façon. Les conditions stratigraphiques de la trouvaille — particulièrement défavorables — ne permettant pas d'en établir précisément la chronologie, il faut attendre, pour se prononcer sur ce point, les résultats de l'analyse des prélèvements de charbon.
Sanctuaire d'Apollon. — Hormis trois tombes tardives, les vestiges fouillés cette année par A. Altherr-Charon et S. Amstad appartiennent aux époques géométrique et archaïque.
L'exploration attentive du bâtiment en fer à cheval précédemment mis au jour à l'Est du temple d'Apollon (fig. 122-123) a permis d'en préciser d'une part certains détails architecturaux (murs en brique crue sur socle en pierre de trois assises au plus, toit en matériau léger soutenu par des poteaux reposant sur des bases d'argile) et d'autre part la fonction : il s'agit d'un atelier de bronzier. On y a en effet mis en évidence une dépression du sol argileux, sorte de cuvette de 0,35 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur, remplie d'argile brûlée, de cendres, de scories et de fragments de bronze informes. Sur le sol se trouvaient en outre un bassin et deux oenochoés en céramique commune, qui confirment le caractère « profane » de l'édifice. Celui-ci peut être daté, d'après l'ensemble du matériel archéologique qui lui est associé, de la seconde moitié du VIIIe siècle av. J.-C. L'intérêt essentiel de cet atelier, outre son ancienneté, réside dans le fait qu'il est situé à l'intérieur même du sanctuaire d'Apollon, tout près du temple.
Au Sud-Est du temple, le muret quadrangulaire qui avait été superficiellement dégagé, en 1955, par Mme I. K. Constantinou, a fait l'objet d'un ultime sondage avant restauration. On a ainsi pu constater qu'il protégeait le couronnement d'un massif circulaire composé de trois à cinq assises de pierres sèches, parées uniquement à l'extérieur, auquel était associé un matériel géométrique homogène, dont quelques tessons brûlés. La situation de ce massif, de même que sa similitude avec la structure contemporaine découverte en 1978 dans la zone Nord-Est du chantier, suggèrent qu'il faisait partie du sanctuaire du VIIIe siècle av. J.-C. et avait une fonction rituelle (autel ?). Contrairement aux conclusions de la fouille de 1955, il semble que cette construction n'était plus visible au VIe siècle av. J.-C.
Le troisième objectif de la fouille, dans ce secteur, était de délimiter l'extension du dépôt votif de la zone Nord-Est, qui se compose d'un massif cylindrique englobé dans des strates horizontales d'argile légèrement sablonneuses bourrés de matériel : tessons d'hydries miniatures du VIIIe siècle av. J.-C, petits objets de type et d'origine très divers (v. BCH 103 [1979], p. 598-599 ; 104 [1980], p. 656-657). Les limites Est et Ouest du dépôt ont pu être déterminées, la limite Nord se perd sous une maison moderne tandis qu'au Sud de nouvelles recherches sont nécessaires.
« Nous savons maintenant, écrivent les fouilleurs, que le massif cylindrique était, au VIIIe siècle av. J.-C, bordé à l'Ouest par un ruisseau. Un alignement de blocs — perturbé lors de la pose d'une canalisation à l'époque hellénistique — protégeait l'extrémité Ouest du dépôt. Quant à la limite Est, elle est nettement marquée par un analemma de pierres sèches, situé à env. 5 m du massif cylindrique. Grâce à une étude stratigraphique, nous savons que ce mur date de l'époque archaïque. Notons aussi qu'aucun tesson d'époque archaïque n'a été trouvé à l'Est de l'analemma. De part et d'autre de ce mur-limite, il y a donc deux ensembles archéologiques distincts. Le premier, à l'Est, n'a plus de lien direct avec le dépôt votif : on y a découvert un puits d'époque hellénistique. Le deuxième, à l'Ouest, est beaucoup plus complexe : les couches horizontales qui entourent le massif cylindrique du VIIIe siècle av. J.-C. ont été perturbées par une fosse, remplie de céramique. La mise au jour de ce dépôt n'est pas achevée ; elle exige, en effet, un travail très précis et minutieux. Néanmoins, nous pouvons déjà signaler que ce bothros se compose presque exclusivement d'hydries miniatures très souvent intactes — plus de 600 à ce jour — datant de l'époque archaïque (fig. 124). Leur forme, leur taille et leur décor varient du plus simple (faites à la main, sans décor) au plus complexe (faites au tour, avec pied tronconique et décor figuré), en passant par de nombreuses variantes tournées, ornées de lignes parallèles rouges ou noires courant sur la panse. Les hydries à décor figuré sont de loin les plus intéressantes : elles présentent une sorte de procession de femmes, parfois couronnées (fig. 125). Ce motif est d'autant plus frappant qu'il se retrouve sur une hydrie miniature d'époque géométrique, découverte dans une des couches entourant le massif cylindrique cité plus haut ».
Il s'agit donc en fait de deux dépôts distincts, localisés l'un autour du massif cylindrique, contre lequel il vient buter, l'autre à l'Est de celui-ci. Le premier se compose essentiellement d'hydries miniatures brisées de la fin du VIIIe et du début du VIIe siècle av. J.-C. déposées en couches successives, le second d'hydries miniatures intactes de l'époque archaïque, jetées dans une fosse à une date encore indéterminée. Il est trop tôt pour dire s'il s'agit là d'un changement de rituel.
« Bâtiment III ». — a vérifié que l'espace qui s'étend au Sud de cet édifice voisin de la porte Ouest était effectivement dépourvu de toute construction.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran