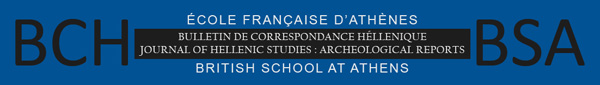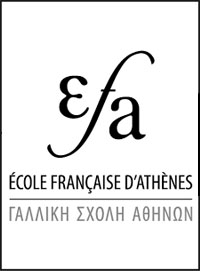LEFKANDI - 1981
Lefkandi
En 1981, la seconde campagne de fouilles menée conjointement par l'Éphorie des antiquités de Chalcis ( ) et l'École britannique ( et ) a amené la découverte de sept nouvelles tombes et permis de dégager l'essentiel de l'édifice protogéométrique découvert fortuitement l'année précédente (v. BCH 105 [1981], p. 850).
Les tombes, qui appartiennent à la nécropole récemment publiée dans Lefkandi I, The Iron Age (BSA Suppl. 11, Londres, 1980), datent de la fin du Protogéométrique et du début du Géométrique Ancien (Xe s.-début du IXe s. av. J.-C). Leur mobilier se signale par l'abondance des pièces originaires du Proche-Orient : objets de faïence, comme des vases (fig. 105) en forme de canard (fig. 106), de lion (fig. 107), de grappe de raisin ou de grenade, et une bague dont le chaton représente une divinité égyptienne à tête de bélier ; objets en bronze comme une situle incisée (fig. 108) ou une cruche dont l'anse est ornée d'un bouton de lotus. Ces trois dernières pièces ont toute chance d'être des importations égyptiennes, tandis qu'une paire de roues en bronze pourrait provenir de Chypre. L'une des tombes les plus riches contenait plusieurs vases attiques du Protogéométrique Récent — parmi lesquels un skyphos décoré d'un oiseau sous chaque anse — et un vase d'origine indéterminée pourvu d'une anse à étai en forme de botte (fig. 109). Dans deux autres tombes on a identifié des importations de céramique thessalienne et macédonienne.
La fouille a montré que le bâtiment découvert immédiatement à l'Ouest des tombes et d'abord interprété comme un temple, était plutôt un hérôon (fig. 110-111). En effet, dans sa partie centrale on a mis au jour, à 2,50 m sous le sol, une tombe divisée en deux compartiments. Dans le premier, les ossements d'un homme, enveloppés dans une étoffe, avaient été placés à l'intérieur d'une amphore en bronze fermée par une phiale. Le rebord du vase est orné d'une scène de chasse en relief, et l'étoffe est tellement bien conservée qu'on peut en observer la texture dans tous ses détails (fig. 113). Une épée et une lance étaient déposées à côté de l'amphore. L'autre partie du compartiment était occupée par une sépulture de femme, en position allongée, parée de bijoux en or (fig. 112) : une paire de boucles d'oreilles spiralées, un pectoral fait de deux disques ornés de spirales au repoussé, une bague, un collier avec pendentif à décor granulé (fig. 114), et, sur la cuisse gauche, des épingles en bronze, en os et en fer doré qui devaient retenir le vêtement. Dans l'autre compartiment se trouvaient les squelettes de trois ou quatre chevaux. Une zone de terre brûlée, à l'Est des sépultures, doit correspondre au bûcher funéraire.
L'édifice lui-même mesure 10 m de large sur plus de quarante-cinq mètres de long. On ignore encore sa longueur exacte, car l'abside qui le termine à l'Ouest est en partie détruite, et le mur découvert à l'Est n'en constitue peut-être pas la limite orientale (fig. 110). Il est divisé en trois parties par deux murs de refend à l'Est et deux petites pièces carrées à l'Ouest. Une rangée de trous de poteaux parallèle aux murs des longs côtés, à 2 m à l'extérieur de ceux-ci, témoigne de l'existence d'un péristyle à piliers rectangulaires. Des piliers identiques, disposés contre les deux faces des murs principaux, devaient servir de supports au toit, apparemment fait de roseaux. Les murs sont en brique crue sur un socle en pierre parfois conservé jusqu'à 1,50 m de haut. A l'extrémité Ouest, certains murs ont versé, peut-être à la suite de l'effondrement d'une tombe à chambre mycénienne sous-jacente. Ce fait pourrait expliquer pourquoi l'édifice, à peine construit, fut abandonné, puis, après la construction d'une rampe en brique crue le long des côtés Nord et Sud, délibérément enseveli sous un amoncellement de pierres, de terre et de briques crues qui fait penser à un tumulus.
Les vases retrouvés sur le sol — en faible quantité vu la brièveté de l'occupation — indiquent clairement que l'abandon et le remblayage de l'édifice datent, comme sa construction, du Protogéométrique Moyen ou du début du Protogéométrique Récent (vers 1000 av. J.-C), tandis que la nécropole adjacente demeura en usage pendant un siècle encore après l'enfouissement de l'hérôon.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran