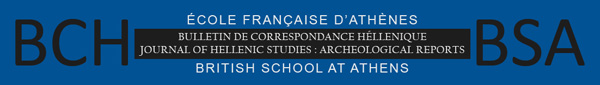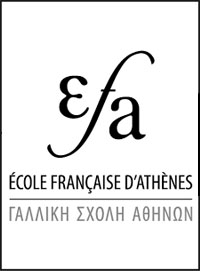DÉMÉTRIAS - 1981
Démétrias, Demetrias, Palais
Fouilles de la Mission allemande. — L'objectif principal de la campagne de 1981, dirigée par (Université de Sarrebruck), était de poursuivre, dans le secteur Sud-Ouest, l'exploration de l'ensemble architectural en brique crue découvert en 1980 (v. BCH 105 [1981], p. 819). Les recherches ont également été poursuivies dans le secteur Nord-Ouest (v. plan fig. 64).
1) Secteur Sud-Ouest. — Le gros mur en brique crue Est/Ouest a été dégagé sur une longueur totale de 21 m. Seul le parement Sud, qui donnait sur une cour à péristyle, était revêtu de stuc polychrome (socle rouge, orthostates bleutés avec imitation des madrures de la pierre, filet noir), tandis que la face Nord, du côté du « vestibule », était simplement enduite d'un crépi d'argile, ce qui prouve que cette pièce était elle aussi couverte. A 2,80 m au Sud du mur, une tranchée de récupération parallèle correspond apparemment à la colonnade du péristyle, dont on a retrouvé, dans la tranchée même et au-dehors, de nombreux fragments de colonnes et de chapiteaux doriques en calcaire coquille enduit de stuc blanc. Le mur n'est percé, sur toute sa longueur, d'aucune ouverture sur le « cryptoportique » situé en arrière. Il servait donc plutôt de mur d'apparat contre la terrasse Nord, supportant peut-être un étage de pièces auxquelles on accédait depuis celle-ci. Sur le côté Est, la cour était bordée par une aile, dont une seule pièce a pu être fouillée complètement (SW 1 : 8 x 6 m, avec porte axiale) et une autre partiellement (SW 2). Elles étaient précédées par un portique presque deux fois plus profond que celui du côté Nord (4,90 m), soutenu par des piliers à demi-colonnes dont on a retrouvé les massifs de fondation en place : longs de 1,20 m et larges de 0,90 m, ils ne sont espacés que de 0,85 m. Le massif de l'angle Nord-Est, qui mesure 2,60 m de long, devait supporter un pan de mur, auquel il faut sûrement rattacher le bloc à demi-colonne, pilastre et quart-de-colonne trouvé en 1980 (fig. 65-66).
Il s'agit donc d'une cour à péristyle de type rhodien, qui, d'après les observations faites sur le terrain, devait mesurer au moins 50 m dans le sens Est/Ouest sur 40 m dans le sens Nord/Sud. Divers remaniements, d'époque macédonienne, ont altéré l'aile orientale : élargissement de la pièce SW 2 vers l'Est et construction d'un escalier au Nord. La destruction de cet ensemble fut intentionnelle et systématique ; les blocs, rarement réutilisés tels quels, furent concassés pour servir de remblai. A Démétrias. seule une résidence macédonienne peut avoir été démolie de cette façon, et cela vraisemblablement entre 196 et 191 av. J.-C. L'ensemble architectural qui s'organise autour de la cour à péristyle est sans doute une résidence urbaine, tout à fait distincte de la citadelle proprement dite, qui lui est postérieure.
La relation de cet ensemble avec les constructions mises au jour immédiatement à l'Est n'apparaît pas encore très clairement. Là, on a découvert, sur une épaisse couche de remblai qui incorpore des éléments de la cour à péristyle, une installation de type artisanal, avec canal d'évacuation, qui fut ultérieurement divisée en trois compartiments. C'est de là que proviennent les deux amphores des fig. 67-68 trouvées en 1980. Les monnaies associées au dernier état n'étant pas postérieures à la fin de la domination macédonienne, cette installation devait être en rapport avec le « palais » fortifié.
2) Secteur Nord-Ouest. — On a poursuivi, de façon relativement limitée, le dégagement des trois gros murs parallèles qui bordaient le côté Nord de la grande terrasse occidentale. Le mur Sud de cet ensemble n'a pu être dégagé sur toute sa hauteur que dans un carré de 4 x 4 m (fig. 69), et l'on a constaté que son retour à angle droit, du côté Ouest de la cour, n'était pas préservé sur plus d'une dizaine de mètres. D'importants tronçons du mur médian ont aussi été mis au jour, dont un au contact avec la prolongation Nord de l'aile occidentale de la citadelle. Dans la partie Est, un mur de refend réunit le mur médian au mur Nord, dessinant une sorte de bastion qui doit être en rapport avec une porte donnant accès à la citadelle depuis la ville. Les murs de cet ensemble monumental, en brique crue sur socle de pierre, étaient revêtus de stuc blanc et rouge sur crépi d'argile. L'ordonnance interne du bâtiment reste à déterminer.
Toute la zone Nord est recouverte d'une couche de terre cendreuse de 0,60 m d'épaisseur qui contenait de la céramique d'époque romaine (de 70 av. J.-C. à 50 ap. J.-C. environ) mêlée à des fragments d'os, de métal, de verre et à des restes de constructions rudimentaires.
L'un des principaux résultats de cette campagne a été de confirmer l'existence de deux phases architecturales distinctes dans la zone de la citadelle. La première est représentée, comme on l'a vu, par une résidence urbaine monumentale en terrasses, construite au début du IIe siècle av. J.-C. et utilisée pendant près de cent ans ; la seconde, consécutive à la destruction délibérée de la résidence vers 191 av. J.-C, correspond à la mise en place d'un établissement fortifié, de plan fondamentalement différent, qui servit effectivement de citadelle jusqu'à la fin de la domination macédonienne sur la Magnésie en 168 av. J.-C.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran