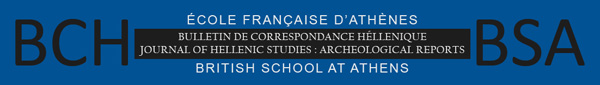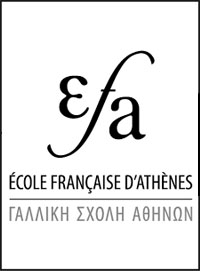CORINTHE - 1981
Antiquité - Archaïque - Classique - Hellénistique - Romaine
Archaia Korinthos, Palaia
Fouilles de l'École américaine. — En 1981 a repris la fouille, interrompue avant la seconde guerre mondiale, de la zone située immédiatement à l'Est du théâtre. Les sondages, presque tous ouverts dans le secteur déjà partiellement fouillé, ont mis au jour des vestiges qui s'échelonnent entre le Néolithique et l'époque ottomane (v. rapport détaillé dans Hesperia 51 [1982], p. 115-163).
1) Néolithique. — Des tessons du Néolithique Ancien et Moyen ont été retrouvés dans des couches en place.
2) Helladique Ancien et Géométrique. — Ces deux périodes sont représentées par de la céramique recueillie hors contexte.
3) Protocorinthien. — Une tombe et plusieurs fosses sont assignables aux deux premières phases de la période.
4) Classique. — Les fosses protocorinthiennes étaient partiellement scellées par une mosaïque en galets du début du IVe siècle av. J.-C. déjà découverte en 1929. Dans l'angle Nord-Est de celle-ci on a fouillé cette année un puits, dont le remplissage inférieur était un peu plus ancien (troisième quart du Ve s. av. J.-C), tandis que les dépôts supérieurs furent accumulés beaucoup plus tard, pendant la première moitié du IIIe siècle av. J.-C. Un deuxième sol en mosaïque de galets, beaucoup moins élaboré, et un autre puits ont été repérés à une dizaine de mètres au Nord des précédents. Une route Nord-Sud, probablement contemporaine des deux sols, passe à l'Ouest de cet ensemble en longeant le côté Est du théâtre. Il s'agit apparemment, si l'on en juge par la profondeur des traces de roues, d'une artère importante, qui reliait la région de l'Asklépiéion, au Nord, à la fontaine de Glaukè et l'Acrocorinthe, au Sud, en passant par la parodos Est du théâtre. Bien que les niveaux anciens de la rue n'aient pas encore été explorés, il est clair que celle-ci existait déjà lorsqu'on y installa, vers 300 av. J.-C, un drain en pierre, remplacé plus tard par une canalisation en terre cuite qui demeura en usage jusqu'en 146 av. J.-C. Dans les dépôts associés à ces drains on note la présence de fragments de coupes italiotes.
5) Hellénistique. — Les principaux vestiges assignables à cette période sont trois citernes pourvues de regards. L'une d'elles en possédait deux, dont le premier a notamment livré une tète aniconique en pôros (fig. 20) que certains détails (cheveux courts, oreilles apparentes, rendu de la carnation en rouge) invitent à considérer comme masculine. Le second servit de cache pendant l'époque romaine (v. ci-dessous). La deuxième citerne possédait un petit bassin rectangulaire et un regard ; la troisième un puits soigneusement enduit. Toutes trois demeurèrent en service jusqu'au sac de Corinthe par Mummius. Elles furent ensuite comblées et recouvertes par des constructions, au cours des cinquante premières années qui suivirent l'établissement de la colonie romaine en 44 av. J.-C.
6) Romain. — La reconstruction de ce secteur, qui semble avoir démarré assez lentement, se traduit surtout par la mise en place d'un nouveau système de rues avec axes Nord/Sud et Est/Ouest. Ce dernier axe est constitué par une rue bordée de colonnes, au Sud de laquelle s'étend un vaste bâtiment de plus de 20 m de long, construit au début de l'époque romaine, puis remanié, avant d'être détruit au milieu du IIIe siècle ap. J.-C. Seule la destruction peut être précisément datée, grâce à une monnaie de Gordien III (240 ap. J.-C.) retrouvée parmi les débris. Associé à celle-ci, un grand panneau de bois incrusté d'un médaillon en verre — tous deux légèrement brûlés — doit provenir d'une porte ou d'un lambris plutôt que d'un meuble. Le médaillon, qui mesure 58 cm de diamètre, est orné d'un groupe de poissons (fig. 21) au milieu d'une étoile à huit branches formée par deux carrés imbriqués. Si les bâtiments romains qui bordent les rues ont été pour la plupart démolis ou tellement remaniés qu'on ne peut les interpréter, les aménagements souterrains, tels que citernes et fosses, sont mieux conservés. C'est ainsi que la cache aménagée dans le regard de la première citerne hellénistique recelait plusieurs vases en verre (fig. 22-23), les restes d'un coffret en bois et une cruche en céramique grossière. L'enfouissement de ce « trésor » est peut-être à mettre en rapport avec l'invasion des Goths en 395, qui, d'après les monnaies retrouvées sur le sol, est la cause de l'incendie et de l'abandon d'une série de pièces à l'Est de la rue du Théâtre. Deux autres puits ont livré plusieurs éléments d'architecture dorique de la fin de l'époque archaïque, dont un chapiteau et un bloc de triglyphe, qui semblent appartenir à un même édifice du début du Ve siècle av. J.-C. Une tête fragmentaire en pôros du VIe s. av. J.-C. (fig. 24) a également été trouvée dans un remplissage d'époque romaine.
7) Antiquité tardive et Moyen Âge. — Après le pillage de la ville par Alaric, le secteur fut remblayé et rebâti à l'aide de matériaux de remploi : dans une tranchée de récupération on a retrouvé de la céramique de la fin du Ve ou du VIe siècle ap. J.-C. (fig. 25). Cette réoccupation fut apparemment de courte durée car, entre le VIIe et le XIe siècle, on n'a pratiquement pas trace de construction. Les tronçons de murs et l'abondante céramique assignables à la seconde moitié du XIIe siècle semblent renvoyer à un établissement de type industriel. En revanche les quelques tessons d'époque franque provenant des niveaux qui les recouvrent ne permettent pas de conclure à l'existence d'un établissement contemporain dans le voisinage immédiat.
8) Époque ottomane. — II en est de même pour les fragments de céramique turque — ou plus récente encore — qui ne sont associés à aucun vestige architectural.
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran