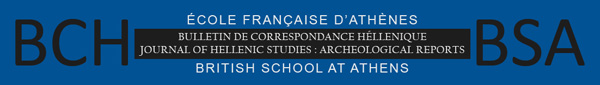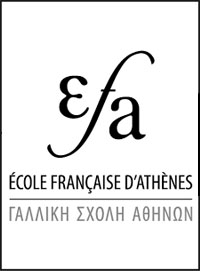PAROS. - Paroikia - 1983
Technische Universität München (TUM) (Université technique de Munich)
Deutsches Archäologisches Institut (DAI) (Institut archéologique allemand)
Paros, Paroikia
Travaux de l'Université technique de Munich. — En 1983 l'équipe de recherche dirigée par a poursuivi ses travaux à Paroikia (Katapoliani, théâtre, « édifice absidal ») et à Marmara.
1) Basilique de Katapoliani. — Deux mille remplois qui sont incorporés dans le groupe d'églises du Ve-VIe siècle ont jusqu'à présent été inventoriés et attribués à des monuments antiques précis. L'étude des groupements et de la place de ces blocs permet de tirer des conclusions sur leur parenté et sur la démolition des bâtiments antiques. Elle éclaire d'autre part l'histoire architecturale de l'ensemble ecclésiastique, qui connaît les cinq phases suivantes :
1. Une villa du Bas-Empire ou un édifice public avec la mosaïque d'Héraklès découverte en 1963 par (v. BCH 88 [1964] Chron., p. 804-816).
2. Une basilique simple du IVe siècle dont la nef principale mesure 8 m de large et dont les colonnes sont fondées sur des blocs de remploi.
3. Une basilique en croix1 à toit plat du Ve siècle, dont les murs extérieurs correspondent à peu près à ceux d'aujourd'hui, et, vraisemblablement construite à la même époque, la chapelle Saint-Nicolas au Nord, à laquelle répond au Sud le diaconicon : tous les remplois proviennent des temples A, Β et C de l'acropole. L'atrium fouillé par doit faire partie de cet ensemble.
4. Le baptistère, que sa coupole sur pendentifs de style primitif invite à dater du début du règne de Justinien, fut ajouté ultérieurement à la basilique en croix. On y trouve des remplois du théâtre et du sanctuaire d'Hestia, mais aussi, comme au mur Nord de la chapelle Saint-Nicolas (v. BCH 106 [1982] Chron., p. 603), un chapiteau de pilastre retaillé à l'époque paléochrétienne dans l'assise de couronnement d'un autel archaïque tardif (fig. 152) : ces deux pièces doivent appartenir à la première église, de même que les fragments d'ambon et le trône episcopal primitif.
5. A la fin de l'époque de Justinien l'église principale fut transformée en basilique cruciforme à coupole — mode de couverture qui fut étendu en même temps à la chapelle Saint-Nicolas — et c'est à cette basilique qu'appartiennent les arcades portant le monogramme de l'évêque Hylasios (v. BCH 107 [1983] Chron., p. 809, fig. 122). L'ancien trône episcopal fut modifié et placé dans le synthronon (fig. 153). On érigea les colonnes du templum actuel et le ciborium, la clôture du bêma étant ajoutée plus tard, sous l'évêque Georges. Parmi les nombreux remplois de cette dernière phase certains proviennent de monuments qui n'avaient pas été démolis jusqu'alors.
2) Théâtre. — On a constaté, en mesurant de façon plus précise les sièges de la proédrie (ibid., p. 810, flg. 124), que leur diamètre (30 m env.) excluait qu'ils fussent placés autour de l'orchestra, dont le diamètre maximum est de 15 m. Ils devaient donc se trouver six à dix rangs plus haut, ce qui évoque la « proédrie supérieure » du théâtre de Priène.
3) « Édifice absidal ». — Une étude minutieuse de l'édifice a montré qu'il ne s'agissait pas d'une église mais plus probablement d'une salle souterraine de type nymphée, appartenant à une villa dont la construction ne fut jamais achevée. Les neuf éléments de gradins remployés dans l'abside pourraient, avec les autres blocs antiques (IVe s. av. J.-C.) incorporés à l'édifice, provenir d'un bouleutérion à 7 rangées de gradins et 190 places (fig. 154). Un bloc de gradin au contact du mur permet de restituer pour ce bâtiment une largeur de 10 m.
4) Marmara. — La découverte de 6 nouveaux tambours de colonnes porte leur nombre à 49, dont 8 tambours inférieurs, ce qui semble confirmer, pour ce temple de la fin de l'époque classique, l'hypothèse d'un plan périptère. On a également identifié un nouveau triglyphe ainsi que des fragments de plinthes de stylobate, de parpaings et d'orthostates. ·
- (1) Postulée par (v. Actes du VIe Congrès International d'Archéologie Chrétienne, Ravenne, 1962, p. 159-168).
Légende graphique :
![]() localisation de la fouille/de l'opération
localisation de la fouille/de l'opération
![]() localisation du toponyme
localisation du toponyme
![]() polygone du toponyme Chronique
polygone du toponyme Chronique
Fonctionnalités de la carte :
![]() sélectionner un autre fond de plan
sélectionner un autre fond de plan
![]() se rapprocher ou s'éloigner de la zone
se rapprocher ou s'éloigner de la zone
![]() afficher la carte en plein écran
afficher la carte en plein écran